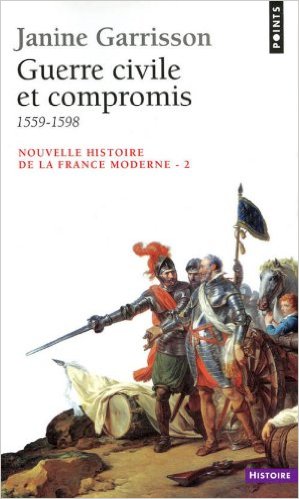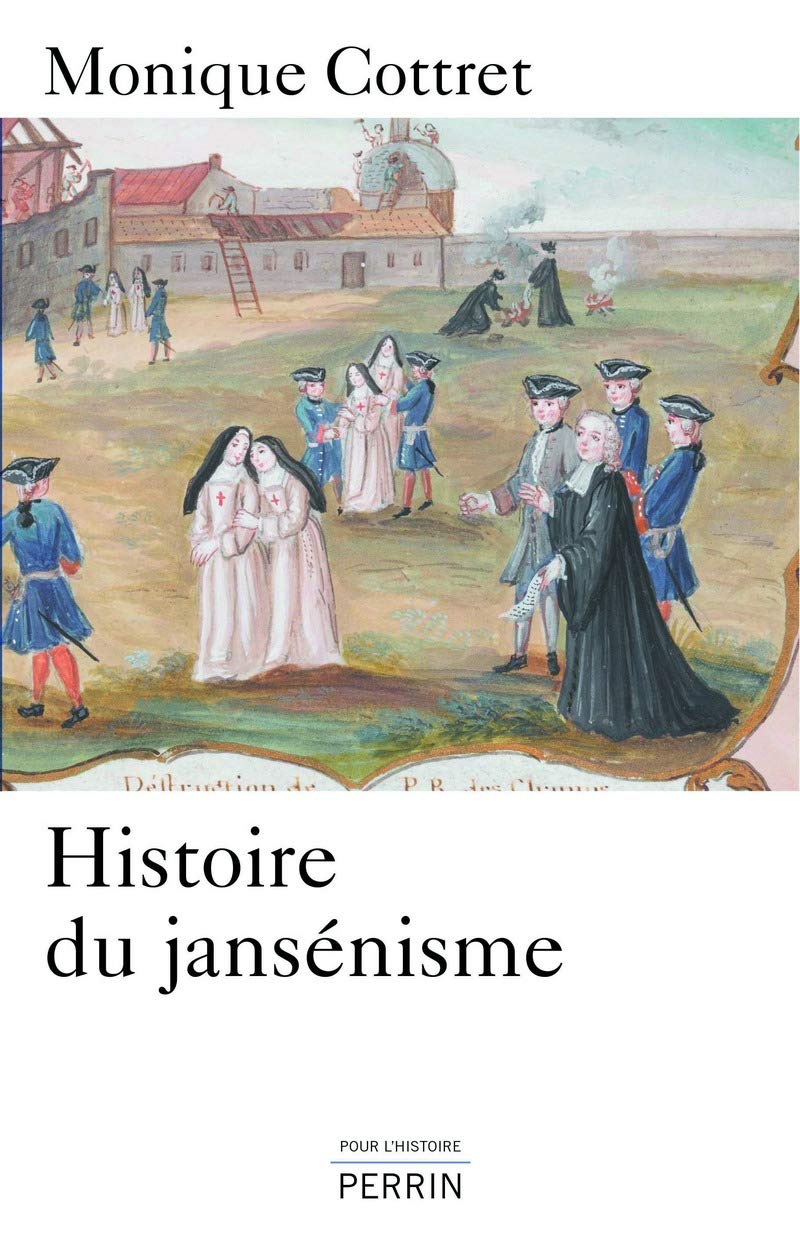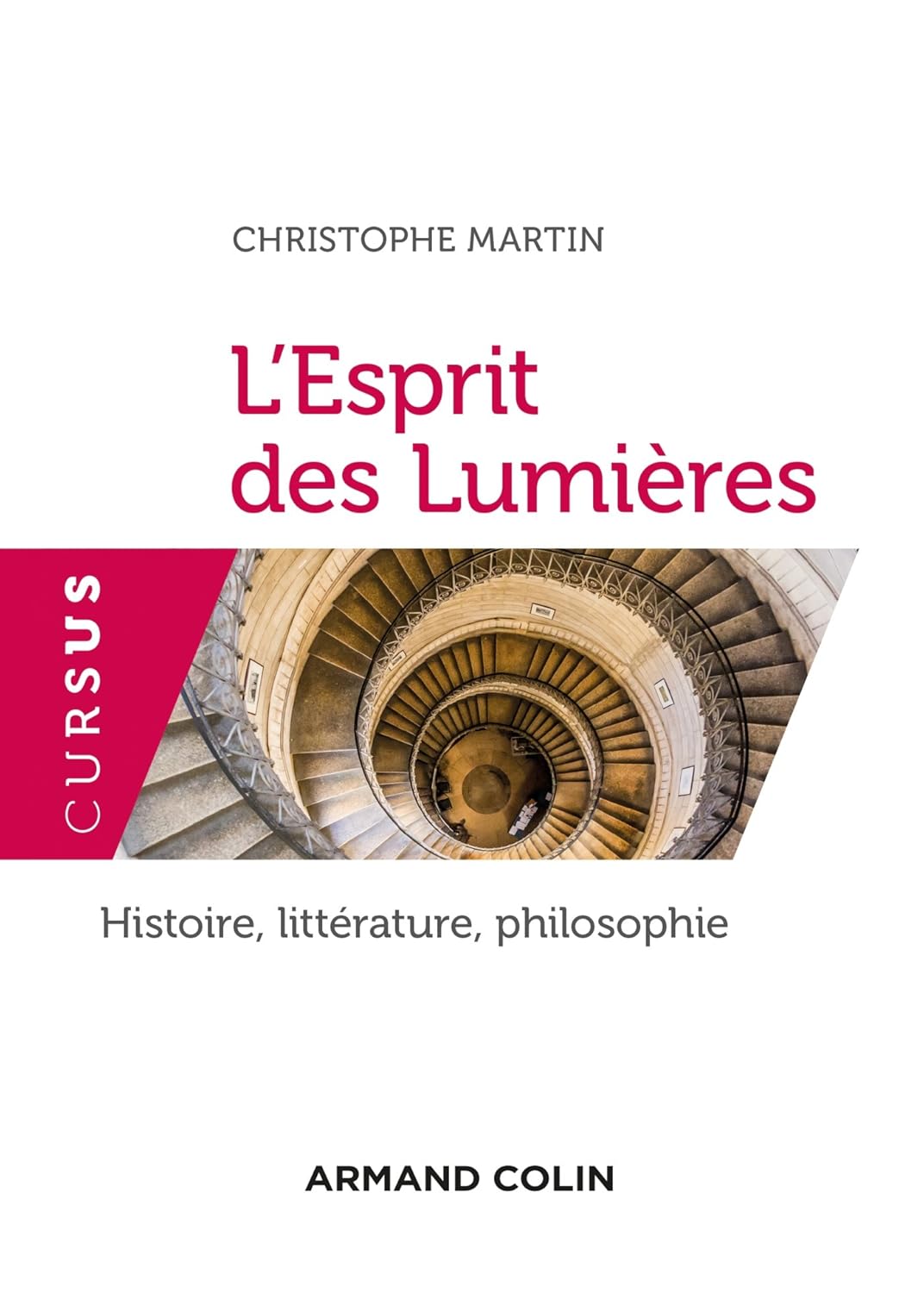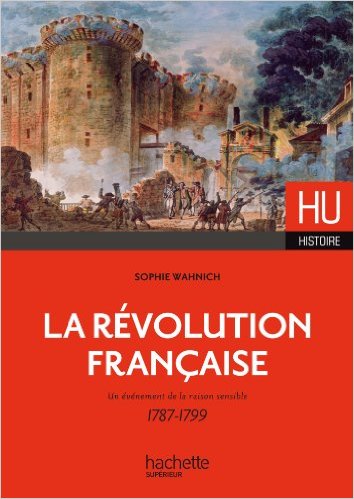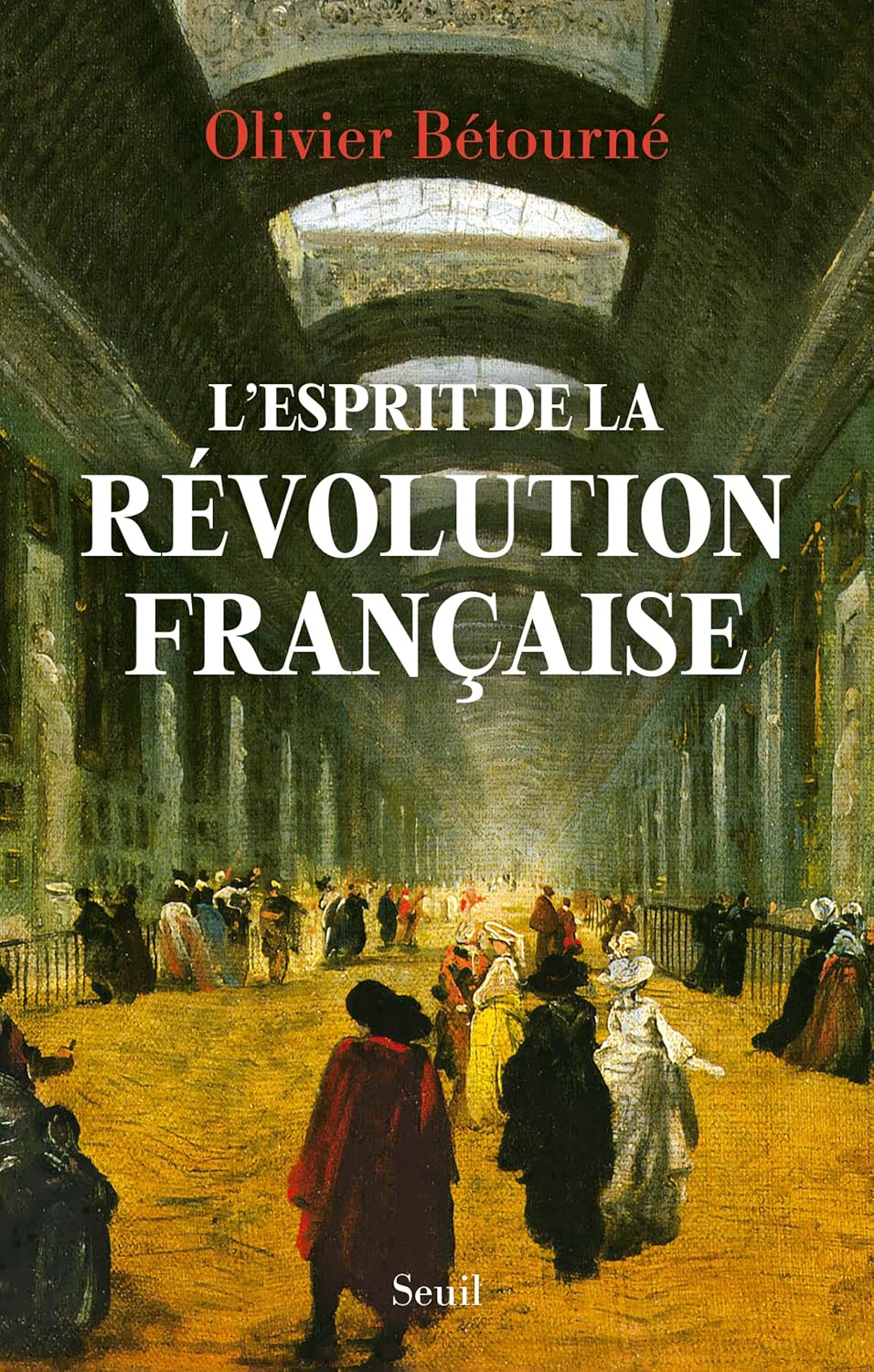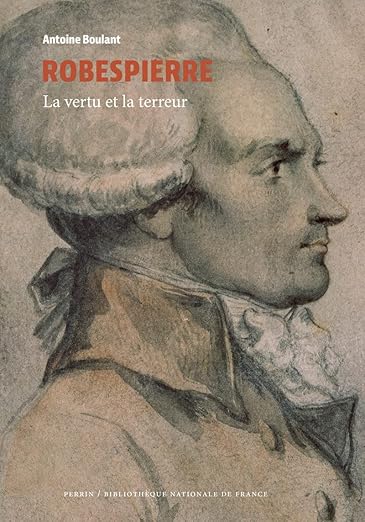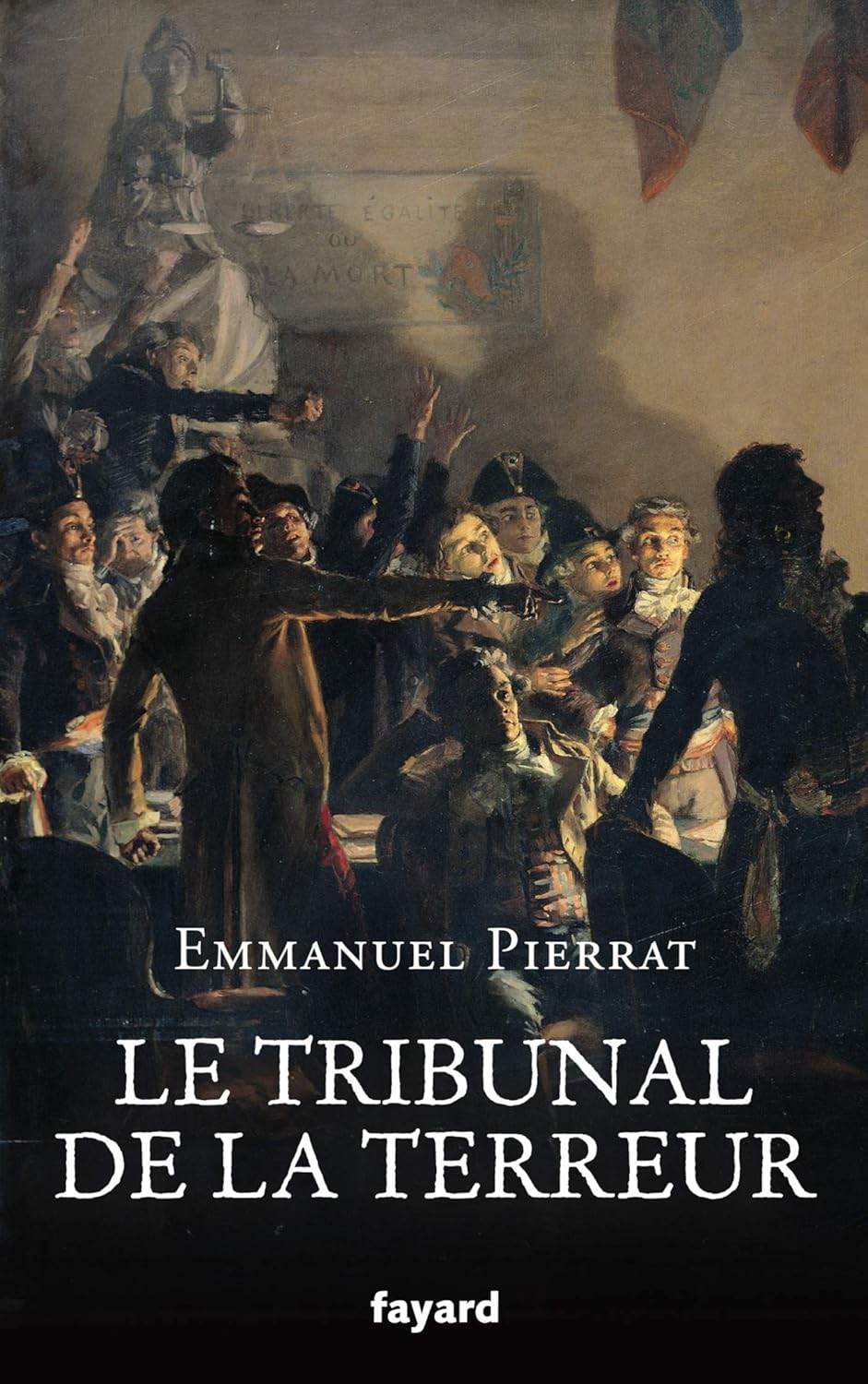|
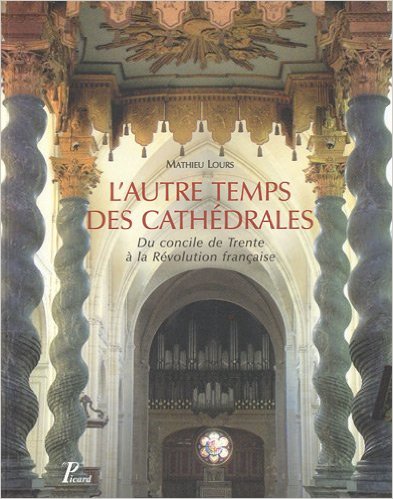
|
Du concile de Trente (1545- 1563) à la Révolution française, les cathédrales de France connaissent le plus important mouvement de transformation de leurs aménagements : remplacement des autels médiévaux, démolition des jubés, bouleversement des choeurs des chanoines, tels sont les éléments les plus connus de ces «travaux et embellissements». Les oeuvres nouvelles alors installées baldaquins, gloires, boiseries introduisent à la fois l'esprit post-tridentin et l'art des XVIIe et XVIIIe siècles au coeur des sanctuaires médiévaux. Répandue à travers l'Europe de la Contre-réforme, l'installation de ces dispositifs s'est opérée en France dans le contexte particulier des traditions liturgiques gallicanes, farouchement défendues par les puissants chapitres des cathédrales. Lancées essentiellement au XVIIIe siècle, après une longue période de maturation, les transformations de l'espace sacré des cathédrales montrent comment le clergé de France a su proposer un cadre adapté à une Contre-réforme qui soit une expression authentique du génie national. L étude des «travaux et embellissements» effectués dans l'ensemble des cathédrales de France, ainsi que la réunion d'une iconographie presque exhaustive sur le sujet, permettent de porter un regard nouveau sur les trois siècles souvent oubliés de l'histoire des cathédrales, «l'autre temps des cathédrales », qui sont pourtant le trait d union essentiel entre les grands chantiers du Moyen-Âge et les restaurations de l'époque contemporaine. Mathieu LoursAgrégé et docteur en Histoire, il est actuellement chargé d’enseignement en histoire moderne et en histoire des religions à l'université de Cergy-Pontoise. Après des travaux portant sur le vitrail parisien à l'époque moderne et à la commande de vitraux dans l'entourage d'Anne de Montmorency, sa thèse a permis de dresser un catalogue des aménagements réalisés dans les cathédrales de France à l'époque moderne. Ses recherches actuelles portent sur le rôle de L’État dans l'architecture religieuse au XVIIIe siècle et l'affirmation des nouvelles expressions architecturales du sacré dans la seconde moitié du même siècle. L'avis de votre guideUn ouvrage qui traite d'une période méconnue de nos cathédrales, mais qui est primordial dans la compréhension de l'organisation de leur espace actuel. Un livre qui n'est accessible qu'à ceux qui ont déjà un bon bagage en histoire de la religion chrétienne et en architecture. Pour ceux-là, ou ceux qui veulent vraiment comprendre "la cathédrale", ce livre est un trésor. De plus il est consultable au musée Rolin d'Autun. |